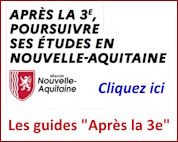Témoignages sur le génocide au Rwanda
popularité : 36%
T�moignages sur le g�nocide au Rwanda
� Un apr�s-midi, quand j’avais cinq ans, des gens arriv�rent chez nous.
� Nos visiteurs s’appelaient des tutsis �, m’expliqua mon p�re, � et il y avait des gens qui les d�testaient �.
Je trouvais cela incroyable parce qu’ils �taient exactement comme nous. �
Paul Rusesabagina,
(Directeur de l’h�tel des 1000 collines)
�Un homme ordinaire �
Ed Buchet Chastel,
mars 2007, page 31
Je m’appelle Paul Rusesabagina. Je suis directeur d’h�tel. En avril 1994, lorsqu’une vague d’assassinats collectifs a ravag� mon pays, j’ai pu cacher mille deux cent soixante-huit personnes dans l’h�tel o� je travaillais.
Quand les membres de la milice et de l’arm�e vinrent m’ordon-ner de tuer mes pensionnaires, je les ai trait�s en amis, leur ai offert de la bi�re et du cognac et les ai persuad�s de ne pas mener � bien leur t�che ce jour-l�.. Cela s’est poursuivi de la sorte pendant soixante-six jours.
Aucun r�fugi� de mon h�tel n’a �t� tu�. Personne n’a �t� emmen�, per-sonne n’a disparu. A travers tout le Rwanda, des gens se faisaient massacrer � coups de machette, mais ce b�timent de cinq �tages a �t� un lieu d’asile pour tous ceux qui arriv�rent � le rejoindre.
Je n’ai rien fait de particuli�rement h�ro�que. Ma seule fiert� est d’�tre
rest� � mon poste et d’avoir continu� � faire mon travail de direc-teur � un moment o� tout ce qui lait le fondement d’une vie d�cente s’effondrait. L’h�tel Mille Collines est rest� ouvert, pendant que notre pays glissait vers le chaos et que huit cent mille per-sonnes se faisaient massacrer par leurs amis, leurs voisins, leurs compatriotes.
Tout cela est arriv� � cause de la haine raciale. La plupart de ceux qui se cach�rent dans mon h�tel �taient des Tutsis, des des-cendants de l’ancienne classe diruzeante du Rwanda. Ceux qui voulaient les tuer �taient pour la plupart des Hutus, traditionnelle-ment agriculteurs. Le st�r�otype courant pr�sente les Tutsis comme grands et minces, avec des nez fins, contrairement aux Hutus, qui seraient petits et trapus. et auraient des nez plus �pat�s ;. Cette division est largement artificielle, un legs de l’histoire, mais les gens la prennent tr�s au s�rieux et ces deux grands groupes coexistent difficilement depuis plus de cinq cents ans.
Ce clivage me d�chire personnellement. Je suis en effet le fils d’un fermier hutu et de son �pouse tutsie.. En th�orie, je suis donc un Hutu. J’ai �pous� une Tutsie. que j’aime de tout mon coeur, et qui m’a donn� un enfant. Ce type de famille est fr�quent au Rwanda, malgr� notre long pass� de pr�ju-g�s raciaux.
Entre le 6 avril, date � laquelle un missile abattit l’avion du pr�-sident Juv�nal Habyarimana, et le 4 juillet, jour o� l’arm�e rebelle tuts�e s’empara de Kigali, la capitale, pr�s de huit cent mille Rwan-dais furent massacr�s. C’est un chiffre qui d�passe l’entendement.. L’esprit ne peut en concevoir l’ampleur. Essayez, et vous verrez ! Huit cent mille vies effac�es en l’espace de cent jours. Huit mille vies par
jour. Plus de cinq vies par minute. Et chacune de ces vies �tait une sorte de petit monde en soi. Un �tre humain qui riait, pleurait, man-geait et pensait, �prouvait de la joie ou de la peine comme n’importe qui, comme vous et moi. L’enfant d’une m�re, irrempla-�able comme ils le sont tous.
. Ce ne fut sans doute pas le plus important g�nocide de l’histoire, mais ce fut le plus rapide et le plus efficace.
mon h�tel a permis de sauver l’�quivalent de deux heures de vies humaines. Retirez deux heures de cent jours, et vous aurez une bonne id�e du peu de chose que j’ai pu accomplir pour lutter contre ce dessein ambitieux.
Mais les Tutsis n’ont pas �t� les seuls � �tre massacr�s pendant ce g�nocide ; des milliers de Hutus mod�r�s. soup�onn�s de sympathiser avec les
I Tutsi et Hutu : quelles diff�rences ?
� Le Rwanda, selon certains Occidentaux, �tait un paradis sur terre, un lieu enchanteur. C’est un petit �tat � l’est de l’Afrique centrale, situ� juste au sud de l’�quateur, � une altitude moyenne d’environ mille cinq cents m�tres. Un pays bord� � l’ouest par le Za�re - aujourd’hui la R�publique d�mocratique du Congo -, au nord par l’Ouganda, � l’est par la Tanzanie, au sud par le Burundi. Pas d’ouverture vers la mer mais de nombreux lacs.
Avec ses 26 338 kilom�tres carr�s, le Rwanda est moiti� moins grand que la Suisse et, cela va sans dire, infiniment plus pauvre, mat�riel-lement parlant. (Le budget annuel de l’�tat rwandais est, pour une popu-lation de huit millions de personnes, celui d’une ville suisse de cent mille habitants.)
Son tr�sor �tait dissimul� dans le bonheur de vivre ensemble ; il nous a �t� d�rob� par le diable.
La seule richesse du Rwanda �tait ses hommes. Ils �taient partag�s en trois groupes ethniques qui cohabitaient paisiblement comme les doigts d’une main : les Hutu, les Tutsi et les pygm�es Batwa. Le Cr�ateur avait offert � ces hommes fr�res un jardin minuscule mais fertile, riche d’un tr�sor qui ne s’estimait pas en dollars, ce qui nous prot�geait - du moins, le croyais-je - de l’avidit� qui mordait le reste du monde : ses montagnes rondes et vertes, ses vall�es baign�es d’une brume bleut�e � l’aube, qui rosit au lever du soleil jusqu’� devenir une lave blonde qui s’�vapore dans la lumi�re de midi. Ses terres fertiles au nord, ses plaines mar�cageuses et ses savanes herbeuses � l’est, ses lacs et ses �paisses for�ts au sud. Ses p�turages o� paissent les vaches inyambo, fines et muscl�es, reconnaissables � leurs hautes cornes en forme de lyre, �l�gantes comme le sont leurs pasteurs depuis la nuit des temps, les Tutsi.
Autres pr�sents du Ciel : l’altitude, qui prot�ge le Rwanda des chaleurs �touffantes et des inondations dramatiques � la saison des pluies ; ses champs de manioc, de sorgho, que cultivent � la houe les Hutu ; ses enfants rieurs (trop nombreux, dit-on, pour un si petit pays, l’une des plus fortes fertilit�s au monde) ; ses oiseaux bariol�s et le concert de piaillements et de sifflements de ces comp�res � travers les for�ts d’eucalyp-tus.
Pas de p�trole, pas de minerais, pas de diamants. Des hommes, des femmes, des enfants. Du caf�, du th�, du coton, des haricots. Chez nous, quatre familles sur cinq vivent � la campa-gne, et neuf familles sur dix tirent leurs revenus du sol.
Une terre et des chants, un point c’est tout. Rien de tr�s int�ressant pour les grandes puissan-ces. Du moins, en apparence...
Notre petit pays allait devenir un enjeu dans la rivalit� entre la France et la Grande-Breta-gne dans la r�gion des Grands Lacs. Chacune chercherait � y consolider son �empire africain �. Paris soutiendrait alors le r�gime hutu franco-phone en place tandis que Londres assisterait l’avanc�e de la r�bellion anglophone tutsi, dont la base arri�re est l’Ouganda, ex-colonie britannique.
Pr�tendre que les Hutu et les Tutsi s’enten-daient comme larrons en foire et que ce fut le m�chant colonisateur qui divisa pour r�gner en soufflant sur les braises de l’alt�rit� serait caricatu-ral. Mais ce n’est pas faux non plus.
Le Tutsi est fin et de haute taille Les Tutsi - minoritaires, l5 % de la population - forment la tribu dont sont issus les rois du Rwanda. Ce sont des nomades, gardiens de troupeaux et vaillants guerriers.
A c�t� du Tutsi, voici le Hutu (dont le nom signi-fie � cultivateur �), plus fonc� de peau, trapu, le visage n�gro�de, nez �pat� et traits plus �pais. Enfin, le Batwa - le pygm�e - plus petit.
Traditionnellement, le Tutsi �l�ve les vaches, le Hutu cultive la terre et le Batwa chasse. Ensemble, ces trois peuples n’en constituent qu’un seul, le peuple du Rwanda.
Dans le paradis des origines, chacun se conten-tait de sa part et rendait gr�ce pour celle de l’autre. Le Tutsi b�nissait Dieu pour les bonnes r�coltes du Hutu et les chasses g�n�reuses du Twa ; le Hutu louait Dieu d’offrir de si belles vaches au Tutsi et de si lourdes proies au Twa.
Comment cette harmonie va-t-elle se briser ? Pourquoi chacune des ethnies va-t-elle se mettre � ha�r l’autre ? Qui va briser le pacte originel ? L’obs�dante question r�sonne, et son �cho me pour-suit : comment l’inimaginable a-t-il �t� possible ? �
Extrait du livre de R�v�rien Rurangwa � G�nocid� �, pages 37 � 41, janvier 2007
II Qu’est-ce qu’un g�nocide ?
1/ Une d�finition
Extrait du livre de R�v�rien Rurangwa � G�nocid� �, pages 13 � 15, janvier 2007
� G�nocide : � Acte commis dans l’intention de d�truire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel� (Petit Larousse).
Le mot g�nocide a �t� forg� en 1944 par Rapha�l Lemkin, juriste am�ricain, juif polonais d’origine, � partir du grec genos (� race �, � tribu �) et du latin caedere (� tuer �). Un g�no-cide vise l’�limination d’une race ou d’un groupe ethnique en tant que tels. Il s’agit de les d�truire pour l’unique raison qu’ils existent.
Apr�s celui des Arm�niens en Turquie, en 1915-1916, et celui des Juifs en Europe, en 1941-1944, le g�nocide des Tutsi au Rwanda, en 1994. est le troisi�me et dernier g�nocide du XXeme si�cle. Ou le quatri�me ? Certains puristes d�nient l’appellation � g�nocide � aux crimes des Khmers rouges perp�tr�s au Cambodge voil� trente ans. Qu’on nous permette n�anmoins d’ajouter cet holocauste � la liste : deux millions de personnes
![]() un quart de la population du Kampuchea - ex�cut�es froidement afin d’� arracher l’herbe avec la racine �. � chaque g�n�ration du XXeme si�cle, donc, son g�nocide.
un quart de la population du Kampuchea - ex�cut�es froidement afin d’� arracher l’herbe avec la racine �. � chaque g�n�ration du XXeme si�cle, donc, son g�nocide.
Si dix mille personnes furent ex�cut�es chaque jour pendant quatre mois, d’avril � juillet 1994 - soit environ un million d’individus - c’est pour la seule raison qu’elles �taient tutsi. Les femmes et les enfants d’abord, comme dans tous les g�nocides, car ils portent l’avenir de l’ethnie.
Cet abattage de neuf Tutsi sur dix - soit un Rwandais sur sept - s’est d�roul� dans un silence assourdissant, au moment m�me o� le mus�e de l’Holocauste �tait inaugur� � Washington et o� les chefs des grandes puissances occidentales c�l�braient le cinquanti�me anniversaire du D�barquement alli� en Normandie en s’adjurant unanimement : � Plus jamais �a ! �
Par indiff�rence, l�chet� ou duplicit�, la communaut� internationale a laiss� s’accomplir au Rwanda un nouvel holocauste en sachant perti-nemment ce qui s’y tramait. L’embrasement g�nocidaire de 1994 a en effet �t� pr�c�d� d’un long � nettoyage ethnique � commenc� en 1959.
Cet acte politique, d�cid� au sommet de l’Etat, fut ex�cut� avec la participation massive de la population hutu. Ses concepteurs avaient pr�vu d’emp�cher toute poursuite judiciaire. Pour cela, il fallait impliquer le maximum de monde parce que, disaient-ils, � on ne peut pas juger tout un peuple. �
Pr�s de deux millions de personnes - hommes, femmes, enfants, vieillards, militaires, pr�tres, reli-gieuses, fonctionnaires, etc. - ont �t� m�l�es � ce massacre syst�matique des Tutsi. Ce qui rend aujourd’hui dantesque et pres-que impossible la t�che de la justice. �
2/ Un g�nocide, c’est aussi d�truire les m�dicaments et les livres
L’auteur, Yolande Mukagasana est infirmi�re, de l’ethnie Tutsi. Lors du g�nocide, elle vit � Nyamirambo, faubourg de la capitale du Rwanda, Kigali.
� Un enfant appara�t � ce moment, je le connais bien. C’est un des voisins de mon dispensaire.
� (Yolande), ils ont forc� la porte du (dispensaire) � coups de revolver et ils ont tout pill�. L’appareil o� tu mets les pinces pour les nettoyer les microscopes, les m�dica-ments. Moi, j’ai pris le t�l�phone pour venir te le rendre. �
Je regarde l’enfant. Je me dis que les enfants sont d�cid�ment devenus les derniers messagers dans un monde de sourds. Je pleure. Je l’embrasse.
�Ils ont aussi br�l� tous tes livres. Ils en ont fait un grand tas dans le jardin, y ont jet� un peu d’essence et ont mis le feu. �
Les imb�ciles. Des livres de m�decine. Ils pourraient leur servir. Mais non. Ils sont trop b�tes pour comprendre cela.
Je revois quelques titres, Pathologie tropicale, Patho-logie chirurgicale, Obst�trique. Ngucire umugani aussi, un livre de l�gendes rwandaises. Tout cela parti en fum�e !
J’aper�ois sur la piste deux femmes qui portent des sacs de m�dicaments vol�s chez moi. L’une d’elles exhibe quelque chose, je distingue un paquet de douze boites de sirop contre la toux. J’entends quelque chose comme : �C’est pour la malaria. �
�Pour la malaria ? r�pond l’autre femme. Ah ! Seigneur, je croyais que c’�tait contre la malaria. �
Je reconnais la voix d’une femme que j’ai soign� une semaine plus t�t. Je vois un enfant que j’ai sauv� nagu�re d’une malaria. J’ai le c�ur gros. Je me sens trahie par ceux-l� m�mes que j’ai aid�s. �
Extrait du livre de Yolande Mukagasana � N’aie pas peur de savoir �, p 34-35, J’ai lu 2000
3 / Un g�nocide, c’est aussi tuer les animaux
Yolande Mukagasana se cache dans une plantation pour ne pas �tre tu�e par des Hutus.
� Je disparais entre les herbes de la plantation. Ce sont de hautes herbes cultiv�es comme fourrage pour les b�tes. Mais il n’y a plus de b�tes, elles ont �t� massacr�es. Leur faute ? Etre poss�d�es par des Tutsi. �
Extrait du livre de Yolande Mukagasana � N’aie pas peur de savoir �, p 50, J’ai lu 2000
Les Hutus sont plut�t agriculteurs. Les Tutsis sont plut�t �leveurs. Voil� pourquoi les premiers tuent les animaux des seconds.
� La vache est chez nous le bien le plus pr�cieux. Elle symbolise la richesse du Rwanda, c’est-�-dire le lait. �
Yolande Mukagasana � N’aie pas peur de savoir �, p143, J’ai lu 2000
4/ Un g�nocide, c’est tuer des enfants
� Un enfant (Tutsi) demande en pleurant � se glisser entre des r�fugi�s dans un camion bond�. Il tente tout pour se glisser entre les corps, n’y arrive pas.
En d�sespoir de cause, il s’accroche au pare-chocs arri�re. Le camion d�marre. L’enfant se laisse tra�ner sur cent m�tres. Dans un tour-nant, ses petits bras l�chent prise.
Il g�t sur la route. Se rel�ve, court encore vers le camion. L’espace se creuse.
L’enfant s’arr�te, prend une pierre au sol et la jette vio-lemment contre le mur d’une maison, exprimant toute sa rage. Puis, il se laisse tomber.
Des Interahamwe accourent, le rel�vent, le molestent et finalement l’abattent d’un coup de machette au milieu du cr�ne. Son corps inerte tombe sur la piste rouge. �
Extrait du livre de Yolande Mukagasana � N’aie pas peur de savoir �, p 154, J’ai lu 2000
Interahamwe : milices cr��es par le pr�sident du Rwanda Habyarimana, groupes de jeunes ch�meurs Hutus que l’on initie au maniement de la machette, dans le but de tuer les Tutsi du Rwanda. Ult�rieurement, la formation de ces miliciens sera �tendue aux armes � feu.
5/ Un g�nocide, c’est tuer des mamans et des b�b�s
� Je vois les tueurs attraper une femme qui court, un b�b� sur son dos. Ils la couchent, lui tranchent les chevilles, puis la t�te. Comme ils reprochent aux Tutsi d’�tre plus grands qu’eux, les Hutu prennent un malin plaisir � � raccourcir � les Tutsi.
Quant au b�b�, un homme le saisit, s’approche de la cabane o� je suis cach� et lui fait exploser le cr�ne en le projetant contre le mur de brique. �
Extrait du livre de R�v�rien Rurangwa � G�nocid� �, page 67, janvier 2007
III Racisme et massacres
� Comment un voisin est devenu, presque du jour au lendemain, notre assassin ? Ce n’est pas facile d’expliquer cela. �
Extrait du livre de R�v�rien Rurangwa � G�nocid� �, page 36, janvier 2007
1/ Un instituteur tue ses �l�ves
L’auteur, Patrick de Saint-Exup�ry, est journaliste au Figaro, laur�at du prix Albert Londres, du prix Bayeux des correspondants de guerre et du prix Mumm. Il fut t�moin du g�nocide tutsi et d�posa devant le tribunal p�nal international d’Arusha.
Le 22 juin 1994, la France re�oit l’autorisation de l’ONU de monter une op�ration arm�e humanitaire ( op�ration Turquoise). Le journaliste raconte ici la rencontre des soldats fran�ais avec les hutu.
� Un homme brise le cercle. Il porte un uniforme de policier rwandais. Il est s�r de lui. Il est � l’auto-rit� �. D’une voix ferme, il s’adresse aux soldats fran�ais qui lui font face et expose la situation :
� Nous avons tu� quelques Tutsi, �a ne d�passe pas la cinquantaine. C’�tait des adultes, mais il y avait aussi des femmes et des enfants. Vous voyez cette rang�e de maisons, � gauche ? Ils habitaient la. On a tout incendi�. Il fallait qu’il ne reste rien. �
Une deuxi�me � autorit� � sort des rangs. C’est l’insti-tuteur de ce bourg de six cents habitants. Il dit :
� Il y a beaucoup de morts, ici. Tous les soirs, des malfaiteurs descendent des collines pour nous attaquer. Nous, on se d�fend. Moi-m�me, j’ai tu� des enfants. �
Le policier explique : � Tout �a, c’est la faute des Tutsi. On les a tu�s parce qu’ils sont complices de la r�bel-lion. On le sait. C’est pour �a qu’on les tue. Les femmes et les enfants aussi. C’est normal : les enfants sont des complices. On les a donc tu�s. �
De la main, il d�signe les carcasses de maisons br�l�es : � On en a incendi� au moins deux cents. Il ne fallait pas que les fuyards puissent revenir. On est des policiers. Ici, chacun a une arme. Avec les villageois, on part le matin et tous les Tutsi qu’on trouve, on les tue. Vous savez, le bourgmestre nous a envoy�s ici, dans ce village, pour faire fuir les malfaiteurs.. C’est ce que nous avons fait. On a des ordres. �
Nous sommes stup�faits, Monsieur(1). Nous �coutons. Abasourdis. Souhaitant avoir mal entendu. Esp�rant avoir mal compris. Nous avons p�n�tr� en un monde o� les instituteurs tuent leurs �l�ves et o� les policiers m�nent la battue.
Imperturbable, presque au garde � vous, le policier poursuit : � On a chass� tous les Tutsi. Mais on n’a pas pu les tuer tous. Ils se sont rassembl�s l�-haut, dans la for�t. Tous les soirs, ces malfaiteurs et leurs complices de la r�bel-lion reviennent nous attaquer. Ils n’ont rien � manger et veulent nous prendre de la nourriture. Nous, on se d�fend.
![]() Monsieur l’instituteur, vous tuez des enfants parce qu’ils sont complices ? �, intervient le colonel (fran�ais), � bout.
Monsieur l’instituteur, vous tuez des enfants parce qu’ils sont complices ? �, intervient le colonel (fran�ais), � bout.
L’enseignant se bloque. Se raidit. Cherche vague-ment � se justifier. Ne trouve pas les mots. H�site. Puis, au d�tour d’une phrase, admet :
�J’avais quatre-vingts enfants en premi�re ann�e � l’�cole. Aujourd’hui, il en reste vingt-cinq. Tous les autres, on les a tu�s ou ils sont en fuite. �
Le colonel (fran�ais) est effondr� : � Vous, instituteur, vous avez tu� les enfants ? �
L’instituteur ne r�pond pas. Le policier municipal vient � sa rescousse : � Moi-m�me, j’ai tu� au fusil dix malfaisants, dont deux enfants. Mon chef m’a envoy� ici pour �a. Il m’a dit que tous les Tutsi �taient mauvais. �
Nous n’en pouvons plus. Le colonel (fran�ais), les traits effondr�s, lance un ordre de repli. Des dizaines de villageois hutu, arm�s de machettes, sont maintenant rassembl�s sur la place du village. L’atmosph�re est oppressante : �Ce soir, dit l’un des habitants de Nyagurati, on va encore atta-quer les malfaisants. �
Un gendarme (fran�ais), dans le bus, dit : �Je n’ai jamais vu �a, c’est de la folie totale ! � Nous l’avons regard�, les yeux las, abattus, morts. Nous �tions d’accord. C’�tait de la folie, bien s�r.
Quand nous avons regagn� la vall�e, les soldats fran�ais n’�prouvaient plus que d�go�t. Auparavant doux aux oreilles, les vivats maintenant les agressaient. �J’en ai marre de voir ces assassins nous acclamer ! �, a l�ch� un gendarme. Nous en avions marre, tous marre.
Extrait du livre de Patrick de Saint-Exup�ry
� L’inavouable, la France au Rwanda �,
p 58 � 62, Ed. Les ar�nes, mars 2004.
(1) � Monsieur � est destin� � M. Dominique de Villepin, ministre des affaires �trang�res, (et futur premier ministre) lorsque Patrick de Saint-Exup�ry �crit son livre .
Cet ouvrage est une lettre ouverte au ministre, un cri de col�re du journaliste, choqu� d’avoir entendu M. de Villepin parler � des g�nocides rwandais � sur Radio France Internationale en septembre 2003.
2/ Le stade et l’�glise de Kibuye
� Le dimanche 17 avril 1994 ; quatre mille trois cent hommes, femmes et enfants avaient trouv� refuge dans l’�glise de Kibuye, en surplomb du lac Kivu. Au stade de Kibuye, le 18 avril 1994, ils �taient neuf mille.
Jusqu’� ce jour d’avril 1994, les immol�s du stade et de l’�glise de Kibuye sont encore des hommes, des femmes et des enfants.
Ils vivent dans de petits villages �loign�s. On leur demande d’abord de se rassembler. On ne les force pas. Pas vraiment. On leur explique que, les autorit�s locales n’�tant pas en mesure d’assurer leur s�curit�, il vaut mieux qu’ils se regroupent. Ils acceptent. Puis on les pousse sur la route. Vers Kibuye. En petits convois. Sous le soleil. Les immol�s marchent. Certains savent d�j�. Ils savent sans r�aliser, ils savent en voulant croire � l’impossible. Je pense qu’en fait, � l’exception des enfants, tous savent.
� leur arriv�e, les immol�s sont rassembl�s au stade et � l’�glise. Des soldats les gardent, leur interdisent de sortir. Chaque jour, il en arrive de nouveau. Certains tentent de fuir et demandent protection aux religieuses du couvent de Kibuye. Des gendarmes et des miliciens, les refoulent. Les religieuses protestent. Impuissantes. Les gardiens affirment avoir re�u des ordres du pr�fet. Lequel expliquera plus tard avoir re�u des instructions du gouvernement.
Le 17 avril, l’attaque est lanc�e. A 14 heures des grenades sont lanc�es des deux collines surplombant le stade. Des tirs d’armes � feu se poursuivent jusqu’� la tomb�e de la nuit, � 18 h 40. Le lendemain, les bless�s et les survivants sont tu�s.
Durant le massacre, toutes les issues du stade �taient gard�es par des militaires. Le stade �tait encercl� de miliciens ou de paysans arm�s de machettes qui tuaient ceux qui tentaient de s’enfuir. Les tireurs auraient �t� identifi�s comme �tant cinq gendarmes, un douanier et les deux surveillants de la prison.
Le 18, tout est fini. Au stade et � l’�glise, du moins. Il ne reste plus qu’� nettoyer, ce qui est rapidement fait. Venus d’autres villages, les miliciens repartent travailler en d’autres lieux. Dans la ville et aux alentours, la chasse se poursuit. � moindre �chelle. Le plus gros est fait, il ne reste qu’� fignoler � le travail �.
Le pr�fet s’appelait Cl�ment Kayishema. Il �tait m�decin de formation. Et � notre arriv�e, il n’avait qu’une priorit� : supprimer la preuve.
Cet amas de quinze mille corps � Kibuye ne constitue qu’une infime partie de ce que fut le g�nocide. Il �quivaut, tout au plus, � deux jours de � travail �. Du 6 avril au 10 juillet 1994, il y eut au moins huit cent mille morts, soit plus de 8000 par jour. Trois mois ont pass� et le pays est devenu un cimeti�re.
Un g�nocide est une action raisonn�e, pens�e par des responsables politiques, planifi�e par des structures administratives. Les engins utilis�s pour �vacuer les corps �taient ceux du � minist�re des Travaux publics �, tout comme � les camions � qui les transport�rent.
Il y avait enfin, cette volont� de masquer, de cacher, de d�rober � la vue. En aucun cas le g�nocide n’est assimilable � une rage soudaine. Quand un crime s’�tale sur trois mois de temps, la col�re n’explique rien.
Durant ces trois jours � Kibuye, Monsieur, nous avons �galement vu passer notre ministre de la D�fense. Fran�ois L�otard est arriv� en h�licopt�re. C’�tait une irruption sans cons�quence aucune. En repartant en h�licopt�re, notre ministre a �vacu� avec lui plusieurs religieuses vers le Za�re voisin o�, je crois, se trouvaient de nombreuses cam�ras. C’est important, Monsieur, les cam�ras...
Extrait du livre de Patrick de Saint-Exup�ry
� L’inavouable, la France au Rwanda �,
p 75 � 83 , Ed. Les ar�nes, mars 2004.
IV La responsabilit� de la France :
� Il faisait chaud, Monsieur, c’�tait l’�t�.
Il faisait beau, Monsieur, c’�tait magnifique.
C’�tait le temps du g�nocide.
L’on n’entendait que les vivats de la foule saluant, dans une ambiance de match de football, l’arriv�e de l’arm�e fran�aise. Nous �tions en juin 1994.
C’�tait il y a dix ans et cela faisait trois mois qu’hommes, femmes et enfants �taient fauch�s comme les bl�s, au rythme de huit mille par jour. La moisson approchait de son terme. Sur des dizaines de kilom�tres, pas �me qui vive.
Les Hutu d�ploy�rent leurs banderoles � Vive la France ! Merci Fran�ois Mitterrand �, agit�rent leurs drapeaux tricolores et se lanc�rent dans des danses triomphales tandis que d�boulaient les soldats fran�ais. Ils �taient heureux, joviaux. C’�tait la f�te. � Vive la France ! �, criaient les tueurs embarqu�s dans le v�hicule. � Vive les Fran�ais ! �, reprenait la foule.
Cette sc�ne avait des airs de lib�ration. Elle n’�tait pas sans �voquer des images vieilles d’un demi-si�cle. Comme si les troupes am�ricaines avaient �t� accueillies en fanfare par les gardiens de Treblinka, en 1945.
En cet �t� 1994, les troupes fran�aises furent accueillies par les tueurs comme des lib�rateurs. Un officier, le capitaine de fr�gate Marin Gillier, rendra compte de � l’accueil triomphal � dans l’hebdomadaire de la marine natio-nale, Cols bleus.
Ce que d�couvrent les soldats fran�ais, ce n’est pas un simple massacre, c’est un g�nocide.
Et le pire, c’est que le pouvoir politique envoya consciemment notre arm�e dans ce pi�ge. Paris venait � la rescousse de ses alli�s ( les hutu). Annon�ant que la France d�ploierait des troupes en terre de g�nocide, le pr�sident Fran�ois Mitterrand venait d’invoquer � l’urgence � et d’affirmer qu’il s’agissait � d’une question d’heures, de jours � : cela faisait douze semaines que le sang coulait � flots. Il � oublia � de mentionner le g�nocide en cours.
� Vive la France ! � crient des enfants agitant un drapeau tricolore. � Vive la France ! � r�p�tent les adultes (hutu).
En ce 26 juin 1994, pr�s de trois mois apr�s le d�but du g�nocide, c’est bien ainsi que parlent les assassins. Ils comptent sur la France. Ils croient en la France. Ils sont convaincus qu’elle va les aider dans leur basse besogne. Nous sommes leurs suppl�tifs, Monsieur. Nous venons � leur rescousse, � la rescousse des assassins. Nous ne cesserons pas de les soutenir.
Extrait du livre de Patrick de Saint-Exup�ry
� L’inavouable, la France au Rwanda �,
p 24 � 28, p 36 et 37, Ed. Les ar�nes, mars 2004.